ARTICLES LITTERAIRES
PROPOSES A VOTRE CURIOSITE : RETOUR A L'ACCUEIL
- ECRIVAINS A VEZELAY
- 3 OPA SUR RIMBAUD
- RESTIF DE LA BRETONNE : UN BOUTE-EN-TRAIN DE LA REVOLUTION
- CONRAD DETREZ : UNE MORT ANNONCEE
- PAUL LEAUTAUD : UN ECRIVAIN FRANCAIS
- LEON BLOY : CELUI QUI APOCALYPSE
- CELINE : LE ROMAN SCIé

Lorsqu’en 1938 Romain Rolland vint s’y installer pour finir ses jours, comme Candide revenant à son jardin - « Mon jardin, sans frontières. J’achève de le désherber de la notion d’étranger. » Romain Rolland dans Le Périple - Vézelay était avant tout cette basilique encore plus forte que belle, rebâtie par Viollet-Leduc après un intermède plus que séculaire d’abandon et de ruine. Le reste, des maisons agenouillées à l’entour, courbant leurs toits, saluant une perpétuelle élévation.
Et, soudain, le bourg renouait avec le passé prestigieux qui en avait fait un haut lieu de la chrétienté médiévale.
« Ils se souvinrent du frisson des grands chênes
Dans la ville romane où Pierre leur parlait
Vézelay, Vézelay… »
même si, comme le dit Aragon, c’est Saint Bernard et non Pierre l’Ermite qui y prêcha une croisade, et que les chênes étaient sans doute des noyers !
Rolland, par son choix, élevait Vézelay au rang des capitales de la pensée. Lui qui fut l’âme du pacifisme et de la raison durant la Première Guerre mondiale, à contre-courant, demeurant quel qu’en fut le prix « au-dessus de la mêlée », qui contribua à révéler les philosophies orientales autrement que comme des curiosités exotiques, qui fut des plus déterminés et des plus en vue dans la lutte anti-fasciste, par sa présence, faisait de Vézelay le réceptacle d’un éclat de la conscience universelle relié au monde entier par les fils secrets, tenus mais incassables de la fraternité qui unit les hommes de bonne volonté.
Car c’est un peu de la sagesse et des espoirs de Tolstoï, Gandhi, Tagore, Péguy, Gorki, Rilke qui fit souche à Vézelay lorsque Romain Rolland y passa. Une part de l’esprit du siècle, une de ses meilleures parts, s’incorporait aux pierres, aux murs, gagnait les ruelles, et envahissait le ciel et le vaste horizon qui se découvre depuis la colline.
Homme de foi que toute religion aurait tenu à l’étroit, Rolland communiait par-delà toutes les contingences : saint laïc, religieux de cœur et libre d’esprit. Citoyen du monde, pèlerin du monde, il est venu ici, empruntant une dernière fois « la route qui monte en lacets », image du cheminement obstiné d’une vie consacrée à déchiffrer autant qu’il se peut quelques bribes de vérités.
Depuis l’installation de Romain Rolland jusqu’à ce jour, en dépit des strictes statistiques qui ne lui accorderaient pas telle place de choix en géographie littéraire, Vézelay a abrité presque continûment au moins un écrivain, comme si une sorte de veille s’était instaurée pour perpétuer l’esprit sur la « colline ».
La guerre avait fait éclater le microcosme littéraire parisien. La poésie, sœur des angoisses et des peines de ces époques troublées, resurgit à Alger où paraît la revue Fontaine de Max-Pol Fouchet - que nous retrouverons bientôt – se bat dans le midi où Pierre Seghers publie « Poésie », rassemble les amis de Jean Bouhier, la future « école » de Rochefort, autour de Max Jacob retiré à Saint-Benoît-sur-Loire - comme pour préserver une relique ?
Elle est aussi un peu à Vézelay.
En 1942 en effet, Paul Eluard y passe l’hiver. Il a trouvé refuge chez Christian Zervos, éditeur et animateur de la revue des « Cahiers d’art », chez qui il avait publié en novembre 1940 « Le livre ouvert I » et où paraît en janvier 1942 « Le livre ouvert II ».
La rudesse du Morvan ajoutée à celle des temps, surabondance de signes qu’Eluard confond en un même refus traduisant son originel mouvement de résistance : « Nous restâmes à cause du froid un mois sans ouvrir les volets ». Il est à Vézelay comme un loup resté au bois, franc-tireur que la faim ne rend pas à merci.
La présence de Georges Bataille, depuis mars 1943 d’abord, quand il s’y installe avec Denise Rollin, puis à partir de mai 1945 de façon plus définitive avec Diane de Kotchoubey de Beauharnais, sera moins éphémère. Il y restera en effet jusqu’en 1949, date à laquelle sa situation financière le contraint à accepter un emploi de bibliothécaire à Carpentras, puis à Orléans.
La pleine signification du lien qu’avait établi Bataille avec Vézelay est désormais le « cimetière où l’on disait que des couples venaient faire l’amour sur la tombe de Georges Bataille, à côté d’Isé, l’héroïne de Partage de midi » (Jules Roy – La saison des Za).
Car, bien qu’il ait connu maintes résidences et passé les onze dernières années de sa vie à Orléans, Bataille fut inhumé à Vézelay.
Qu’y avait-il qui puisse faire s’accorder la rusticité de Vézelay et l’élégante et intellectuelle scolastique de Bataille ? Bataille si scandaleux et si civil !
Qui se trouvait ici de cette vivante contradiction : l’homme de foi, tenté dans sa jeunesse par la vie monastique et la prêtrise au point d’être entré au séminaire, ou cet écrivain des plus obscènes que la littérature a connu, l’auteur à l’odeur de soufre de l’ « Histoire de l’œil », de « Mme Edwarda » ?...
L’époque de Vézelay pour Bataille est celle de la rédaction de l’« Expérience intérieure », comme si, en ce décor de pierres qui lui offrait des assises certaines, il avait pu enfin inventorier son horizon spirituel.
« Je ne veux plus, je gémis
Je ne veux plus souffrir
ma prison.
Je dis ceci amèrement :
mots qui m’étouffent, laissez-moi,
lâchez-moi,
j’ai soif d’autre chose. »
Le supplice, dans l’Expérience intérieure.
L’éructation, le blasphème n’étaient-ils pas, comme chez Sade à qui le lie cette volonté farouche de ne penser que par soi-même et de résister à toute facilité de système, trop extrêmes, trop violents pour n’être, comme visiblement, qu’une négation de Dieu ? Ne s’agit-il pas là plutôt à la fois, d’une épreuve de purification où le mot assainit l’esprit, le lave, le vide de ce qui, en écume, vient couvrir le papier, et d’une provocation à l’égard de Dieu afin de le contraindre à se manifester. L’excès de négation n’est-il pas le signe même que cette négation par trop redondante est inopérante, que l’esprit qui nie l’objet cherche en fait à l’expulser ?
A Vezelay, Bataille se défend pied à pied, disputant avec les mystiques et ascètes de tous les temps dont il anime les ombres gigantesques . Son voyage à lui, son « expérience intérieure » a la vertu ambitieuse de ne s’assigner par avance aucun but : pas de salut de l’âme à assurer, pas de réincarnation dégradante à craindre, et donc pas de calcul, pas de projet, pas de limite ! Une seule volonté : devenir la proie de l’inconnu, sachant « que l’extrême est accessible par excès, non par défaut ». Ne pas entreprendre ce voyage pour ne redécouvrir au bout du périple que les guenilles entassées dans la malle que l’on a garnie au départ !
Peut-être est-ce ici seulement, dans cette campagne « taiseuse », réfractaire à sa liturgie orgiaque, qu’il pouvait recréer le désert où vient s’éteindre toute parole, retrouver l’accord profond qui le lie au drame nietzschéen. Nietzsche « homme brûlant, solitaire, sans dérivatif à trop de force, avec un rare équilibre entre l’intelligence et la vie irraisonnée », pour qui Bataille « brûle comme par une tunique de Nessus, d’un sentiment d’anxieuse fidélité ».
Mais, si Vézelay eut sa part d’ombre, Bataille :
« Le néant n’est que moi-même
l’univers n’est que ma tombe
le soleil n’est que ma mort »
L’archangélique et autre poèmes.
Il eut aussi sa part de lumière : Max-Pol Fouchet.
Il n’était que de voir son regard et de regarder ses mains. Cet homme-là ne pouvait se suffire de vivre à Paris, d’ailleurs, sa poésie est trop pleine de ciels, de plaines, d’arbres, de versants boisés, de cris d’animaux dont il partageait et respectait le secret.
« Qu’un peuplier sur l’espace un doigt sur les lèvres
A jamais taise le secret dans le rouissage du jour
Perdons-le dans la neige, le sable la verdeur vivons
Comme si nous ne savions rien des fumures du labour
Sur le tour des saisons monte la poterie des collines
Des taillis de la nuit les chiens ont levé le jour
Au tableau de l’école un enfant dessine le ciel
Roule une pierre
un oiseau crie
nous avons oublié ».
Max-Pol Fouchet vient s’installer à Vézelay en 1957, conscient de tout ce qui le tient hors du monde tel qu’il se construit : regrets, remords, chagrins. « Le Front populaire, la guerre d’Espagne, la débâcle de 40, la Résistance – échue finalement aux mains des politiciens – le péril atomique, la guerre d’Algérie, tous ces espoirs morts, ,ces désespoirs vifs, marquent désormais notre passage sur terre ».
Vézelay est ainsi l’aboutissement naturel de la rupture qu’il avait de long temps engagée par toutes ses approches des hommes différents, peuples oubliés, cultures moribondes, civilisations détruites, mondes arrêtés que condamne notre modernité. « Les peuples nus », « Terres indiennes », des témoignages d’une quête dont « la vertu insatisfaisante du voyage» ne fait qu’attiser en lui le besoin. Partout, identifier le primordial dans l’humain, et ici, pouvoir longuement, dans la petite forteresse de pierres, dans l’ « enveloppement fraternel des vieux murs épais », le cultiver et le préserver.
Il ne cherchait pas autre chose en poésie : « Est bon ce qui permet à l’homme la découverte de l’homme. Mauvais ce qui lui cache l’essentiel » (Introduction à la « Poésie française »).
Vézelay fut le pendant d’une vie d’homme public que la télévision en particulier – Max-PolFouchet participa à « Lecture pour tous », anima l’émission « Le fil de la vie », produisit des films pour « Terre des Arts » - aurait pu dévoyer. Ici, il a pu renforcer la capacité d’intransigeance qu’il sut opposer à toutes les sirènes du pouvoir, et qui lui permit de demeurer à son souhait, homme de clarté et de justice.
Et les sanctions des maîtres de notre République n’ont pu le faire céder, lui qui, bouquet final, en mai 1968, s’engagea, à son habitude, dans compter, en tant que président du syndicat des producteurs de télévision au point d’être alors jugé indésirable à l’ORTF. Hommage rendu à sa vertu qu’il sut recevoir comme tel, puisque, dès lors, il s’écarta définitivement de la télévision.
Max-Pol Fouchet devait demeurer vingt-cinq ans à Vézelay. Tendait-il lui aussi un pont vers sa jeunesse, lui qui disait travailler à rattraper le temps perdu ? A douze ans, paraît-il, il se voulait franciscain. A vingt et un ans, découvrant saint Thomas d’Aquin, saint François d’Assise et Emmanuel Mounier dans le cadre propice du massif de Belledonne, il rédige trois textes empreints d’une crise mystique qu’il partage avec le peintre-poète René-Jean Clot qui signera les lithographies de ces « Histoires saintes ». Là s’arrêtera il est vrai son évolution dans ce sens. Son goût de l’action et sa soif de vie le portant alors durablement vers d’autres préoccupations, renforçant avant tout le combattant, l’ethnologue, le citoyen du monde soucieux de liberté, clamant l’innocence de l’homme :
« Je remonte vers l’empire du verdict, où s’élève trop rarement la protestation : « Je ne suis pas coupable », le solitaire cri d’un poète parmi les chasses de plomb, vite étouffé par les tonnerres de la menace, par les psaumes des grands inquisiteurs » ( Les peuples nus).
Et la proximité des symboles ne forcera pas sa détermination.
A l’heure de la mort, en août 1981, recevant les hommages conjugués d’un père franciscain et de Jules Roy accueillant sa dépouille en la basilique de Vézelay, ce sera au cours d’une cérémonie laïque, à l’image du respect et de la tolérance dont faisait preuve Max-Pol Fouchet, en accord avec sa volonté de n’être d’aucun église pour mieux demeure fidèle à ses croyances.
Au cours de cette même cérémonie, Jules Roy évoquait un autre écrivain, ayant résidé à Vézelay, disparu un peu plus d’un an auparavant : « … parfois, dans la nuit, Maurice Clavel… venait à lui (M-P. Fouchet), à sa lumière, l’appelait… ».
On imagine très bien dans la clarté lunaire la grande silhouette de Clavel, sa tête de chouette ébouriffée, aux yeux démesurément ouverts par les loupes de ses lunettes, claquant le pavé, troublant le calme trop habituel de Vézelay, Clavel, ici comme partout, « grand perturbateur des consciences et du sacré ».
D’où est venu qu’un tel bretteur, « méridional robuste », toujours entre deux scandales, entre deux diatribes avait éprouvé le besoin de s’installer à Vézelay , lieu chargé d’histoire, certes, mais qui ne pouvait nourrir la partie active de son existence ?
La vie de Maurice Clavel s’articule nettement autour d’une crise formidable, résistant cinq ans à tous les traitements -physiothérapie, psychanalyse, cure de sommeil…- et qui ne céda finalement que devant son acceptation de la Grâce -« maladie désirable », selon ses propres termes.
Cette expérience terrifiante qu’il relate dans « Ce que je crois » et pour laquelle il cite les mots de saint Jean de la Croix : « On se sent suspendu en l’air par les mâchoires avec des crocs de boucher », détermina chez lui ce christianisme primitif, farouche, exigeant, mystique qui lui faisait rejeter avec véhémence les exégèses et les gloses des « sages et des docteurs », et dénoncer avec humeur toutes les philosophies chrétiennes, monstres de l’esprit à le croire, « des jésuites heideggeriens, dominicains phénoménologues, maristes marxistes et autres franciscains structuralistes ».
Avec la fougue qui, paraît-il, caractérise les convertis, Clavel s’engage sur la voie du petit pauvre d’Assise, ce qui explique peut-être Vézelay où son installation date de cette conversion au catholicisme. Etait-ce désir de lui associer un lieu consacré, de se rapprocher de la tradition ici symboliquement exposée, de manifester publiquement la profondeur de son adhésion , de se mettre mieux à portée dans ce silence et cette solitude de la Révélation ?
En ce lieu où Bataille indiquait un inconnu dont il ne voulait rien présupposer, mais qu’il désirait connaître, Clavel établit un Inconnaissable dont l’existence attestée par la foi ne peut être réfutée par le savoir, la raison ou la science…
Foin du rationalisme au service de la foi ! Clavel, répudiant deux siècles de philosophie qui ont cru faire mourir Dieu, puis l’homme lui-même, fait sienne cette proposition de Kant, bien unique dans l’œuvre du maître à trouver grâce à ses yeux : « J’ai limité le Savoir pour faire place à la Foi ».
Clavel crut advenu le monde où se révèleraient les vérités qu’il assénait contre les facilités anéantissant la France réduite « per Pompidolem… à des veaux à gros et petits engrais ». Il vit l’éclosion de mai 1968 des yeux du jardinier qui contemple de jeunes tiges en y reconnaissant les graines qu’il a naguère semées. Cet « an zéro d’on ne sait trop quoi » lui fut l’occasion de tenter une synthèse difficile de ses attachements avoués et secrets, de se clamer dans la cohue « gaullo-gauchiste », comme pour rappeler le Général de Gaulle – le père ? - fourvoyé dans la gestion d’un fond de commerce, que Clavel lui conseillait de remettre à Giscard ou Lecanuet, à son destin historique.
Cette croisade qu’il prêcha ne fut que partie remise. Mais s’il connut ensuite des « oublieux, des désespérés, des idéologues stériles, des désséchés et racornis », lui demeura confiant en une nouvelle fracture. Une de ces ruptures que Michel Foucauld –que Clavel reçut à Vézelay- a identifié comme fondation des différents âges de la pensée et dont Clavel espérait que la prochaine accorderait enfin les hommes avec la Vérité - sa vérité ?
L’actuel « locataire » de Vézelay, car il en demeure un, est Jules Roy, « le guerrier devenu un rêveur d’idéal et de justice ».
Venu d’Algérie comme Max-Pol Fouchet, mais par d’autres chemins, plus tortueux, plus douloureux aussi, non pour goûter le calme bonheur qui se peut rencontrer en cette retraite, mais plutôt pour trouver refuge, à la manière de ces chiens - qu’il affectionne tout particulièrement - qui se cachent pour lécher leurs plaies.
« Qu’est-ce qui l’avait poussé ici, sinon l’instinct des éléphants qui retournaient dans un coin de brousse pour y mourir ? » se demande-t-il dans « La saison des Za », où il évoque sous le couvert d’un roman, sa vie sur le mode tragi-comique, apparaissant, lorsqu’il s’installe à Vézelay, après avoir longtemps tourné autour du bourg, un peu comme un satyre vieillissant hantant la basilique pour mieux toucher la Madeleine pour qui brûle son cœur, mais pour qui s’allume également une certaine lueur en son œil !
Sur un ton plus grave, dans une confession intitulée « Etranger pour mes frères », qui ne peut sonner qu’amèrement, il conte les épisodes d’une vie qui l’amenèrent à chercher ici, définitivement, un dernier réconfort : « Ma vraie patrie, c’est le cœur profond… de Vézelay, uniquement de Vézelay… quand on a connu les drames des deux guerres mondiales et de deux guerres coloniales, on est au bout de soi. »
Et au bout de soi, heureusement, pour Jules Roy, il y a encore l’écriture, qui fut à plusieurs reprises le recours, la seule possibilité de laisser sur le sable du quotidien, en des moments cruciaux la trace de difficiles mais indispensables choix. « Tout est condamné, même les pierres, mais les maisons sont ce qui dure le plus. Pour moi, l’écriture est une maison…, une église illuminée. »
Jules Roy a vécu de désillusions en déchirements. Décillé par la marche du siècle, il termine seul, intègre, dépouillé, nu, mais sauf, pour avoir su se préserver jusqu’à Vézelay où plus rien ne l’atteindra d’essentiel, car le voilà forgé.
Et pourtant, même l’écriture l’a en quelque sorte trahi, qui lui a procuré son plus grand succès pour une œuvre à l’origine de commande « Les chevaux du soleil », qui met en lumière un auteur de roman historique, masquant le moraliste et l’homme de combat. Or cette saga de la présence française en Algérie est avant tout la recherche par Jules Roy de ses racines et la recréation de tout ce qui amena un conflit qui fut la plus lourde blessure qu’il eut à porter.
La guerre d’Indochine, pour laquelle il crut de son devoir de se porter volontaire, marque la première rupture entre l’aviateur Jules Roy, Prix Renaudot pour son récit « La vallée heureuse », et l’armée qu’il considérait jusque là comme sa famille naturelle. Tenu à l’écart, suspect pour cause de réussite littéraire et de fréquentation de l’ « intelligentsia » (entre autres Camus, Amrouche, Pierre-Jean Jouve, Roblès, « l’école d’Alger » réunie après guerre à Paris autour de l’éditeur Charlot) le voilà relégué au rôle d’observateur livré dans l’inaction aux doutes et aux interrogations. « Quand les soldats commencent à réfléchir, aucun d’eux ne reste dans les rangs ». Ce précepte de Frédéric II trouvera en ce qui concerne Jules Roy son application en 1953.
Nouvelle épreuve, nouvelle déchirure : l’Algérie. Pour Jules Roy, enfant de ce pays, ce sont des deux côtés des amis qui meurent. Des soldats, dont il se sent encore solidaire comme il le confie en un article intitulé « Je vous plains, mes camarades » paru en 1958, soldats bientôt perdus, dont « normalement j’aurais du être », dit-il. Mais aussi des hommes comme Mouloud Feraoun, directeur d’école à Alger, romancier attaché à son terroir de Kabylie, dont le journal, achevé tragiquement le 15 mars 1962, jour où l’O.A.S. l’exécute, laisse mesurer combien cette guerre fut réellement fratricide. Jules Roy l’avait visité en 1960, lors d’un séjour d’un mois qu’il fit en Algérie pour le compte de l’Express, et au cours duquel lui apparut l’issue inéluctable qu’imposaient la justice et les épisodes les plus récents de ce qu’il dénonça, en dépit des déclarations officielles , comme « la guerre d’Algérie », en un livre qui brisait les ponts à la fois avec ses anciens compagnons d’armes et avec ses compatriotes pieds-noirs.
Au-delà d’autres péripéties plus intimes, la mort de sa mère, celle de Camus, le silence de de Gaulle à son endroit reçu comme une punition pour ses prises de position au sujet de l’Algérie, les fâcheries avec Doyon, écrivain baroque et méconnu, son père spirituel, jaloux et tyrannique, il restera donc Vézelay pour remplacer la patrie perdue dans le déchirement : Vézelay devenu maison et patrie à la fois, pour les accueillir lui et sa compagne.
Et, au cœur de Vézelay, la Madeleine, qui pour être tant soit peu infidèle, « la basilique… à ma disposition six mois par an… Le reste du temps, je la partage de mauvaise grâce », n’en demeure pas moins le seul lieu où désormais Jules Roy sait retrouver la lumière, la beauté, la vérité, mais non la paix.
« … il arrive qu’on se brûle à la flamme que produit la lumière ou que trop de lumière gêne… Du face-à-face avec le sacré on sort comme du combat avec l’ange, rompu, brisé… »
Pas une école, non, pas même une confrérie. La filiation entre ceux qui se succédèrent à Vézelay est incertaine, voire, improbable, mais le hasard n’est pas pour autant l’unique auteur de cette nébuleuse aux étoiles d’âges différents.
Sur la colline, chacun est venu chercher suivant son tempérament et son histoire un aboutissement qui ne pouvait se révéler qu’en un lieu éligible par l’esprit. Une part d’eux-mêmes s’y trouvait déjà avant qu’ils ne s’y installent !
Rolland y trouva la sérénité que donne la foi en l’avenir de l’homme, Bataille la possibilité d’y approfondir la voie mystique. Max-Pol Fouchet y épanouit un art de vivre qui est avant tout partage et Clavel les fondements de vérités salvatrices affirmées par-delà la raison. Et Jules Roy y entretient cette lumière qui n’existe que par celui qui la voit, à l’écart des hommes, dans le repos que donne la vénération à Madeleine,
« Toi l’amie de tous les pardons
Qui n’est douce au guerrier que lorsqu’il est blessé »
Maurice Druon – Vézelay, colline éternelle.
( Jules Roy est décédé le 15 juin 2000 à Vézelay)
Jean-Michel Lévenard
Cet article a été publié en 1988
dans la Revue FLORILEGE.
Revu et mis en blog
Pour la Fête à Grandgousier
au mois de Bouffe
l’an X de la Cass’Hure
Le 17 juillet 1890, un certain Laurent de Gavoty écrit à « Monsieur Rimbaud à Harar » : « Je serais heureux et fier de voir le chef de l’Ecole décadente et symboliste collaborer à la France moderne dont je suis le directeur».
Insolite de voir ainsi qualifier Rimbaud qui ne fit rien pour se voir sacrer chef de file d’une quelconque école littéraire.
Lors de ses séjours parisiens de 1871-1872, ses relations avec les milieux littéraires s’inspirent plutôt d’une rude indépendance frisant parfois le mépris. Léon Valade, évoquant sa présence au sein de la confrérie des
 « Vilains Bonhommes », écrit : « C’est Satan au milieu des docteurs ».
« Vilains Bonhommes », écrit : « C’est Satan au milieu des docteurs ».En fait, l’histoire n’a retenu, concernant sa fréquentation des Vilains Bonhommes – un groupe parnassien qui se réunissait pour banqueter mensuellement depuis 1869, et auquel appartenait bien évidemment Verlaine – que l’épisode d’une vague querelle au cours de laquelle Rimbaud infligea au photographe Etienne Carjat une égratignure à la main d’un coup de canne-épée.
Ses relations furent plus étroites avec les « Zutistes », qui tenaient réunion dans l’entresol de l’Hôtel des Etrangers, loué pour loger le musicien Cabaner, et abriter Rimbaud que l’on attendait –« Venez chère grande âme, on vous attend » -, et que l’on savait sans ressources. Si quelques membres des Zutistes appartenaient également au groupe des Vilains Bonhommes – dont Verlaine bien sûr – ils s’en distinguaient par une sensibilité généralement procommunarde et une propension à brocarder un Parnasse jugé un peu trop guindé.
Il reste de l’activité bachique de ce groupe d’une vingtaine de personnes un « Album Zutique » de 120 pièces révélé au public par Pascal Pia en 1943.
On compte vingt pièces de Rimbaud dans cet ensemble, données entre fin septembre 1871 et début juillet 1872. Puis, il rompt tout lien avec cette joyeuse troupe dont on ne sait exactement jusqu’à quand elle poursuivit ses séances d’improvisation collective ( septembre 1872 ?) durant lesquelles on cultivait par la technique de l’arrosage par excès, les dons de chacun à la parodie obscène ou burlesque. Rimbaud ne révèle pas dans sa collaboration à cet album d’autres soucis que de se livrer à des compositions ludiques, lutines, indécentes et impudiques, ignorant de toute considération de fondements, tout au moins théoriques.
Mais, l’œuvre de Rimbaud, de laquelle les pochades de l’album zutique ne participent pas vraiment, est élaborée dans une magnifique indépendance, marquée du signe de cette liberté qui fut son exigence au-delà de la poésie, dans sa quête de la « Vraie Vie ».
Cette œuvre fulgurante, peu publiée par ses propres soins, dont il se montre rapidement insoucieux, sera révélée par bribes à ses contemporains, après sa « désertion », par Verlaine, qui s’acquittera de cette sorte de sacerdoce avec une obstination méritoire, et une réelle abnégation, jusqu’à valoir à Rimbaud une notoriété certaine dans les milieux avertis.
Le personnage, l’œuvre, sont de nature à attirer l’attention et à servir de point d’ancrage. Les symbolistes, dont l’image à l’origine est renvoyée, mais aussi déformée, par les « Déliquescences « d’Adoré Floupette, poète décadent - en fait une parodie dont la nature fut controversée, due à Gabriel Vicaire et Henri Beauclair - ne pouvaient que se complaire à se réclamer d’une paternité aussi prestigieuse que mystérieuse à la fois.
L’aura de scandale qui accompagnait la renommée de Rimbaud n’était pas non plus sans lui conférer à leurs yeux « une once de plus-value » et sa disponibilité – on ne savait plus, pas même Verlaine, si Rimbaud était encore en vie – était une qualité de plus.
En effet si, comme le déclarait Izambard « (Rimbaud) se trouva décadent sans le savoir, sans le vouloir, sans avoir jamais parlé ni écrit – relisez-le – l’impayable jargon de cette école « , les symbolistes nous prouvaient facilement le contraire.
Et c’est ainsi qu’entre 1886 et 1888, les revues symbolistes produisirent un certain nombre de pièces de Rimbaud fondant et confortant leurs choix esthétiques, écrites pour les besoins de la cause, par Laurent Tailhade, Maurice du Plessys, Ernest Raynaud, ou encore Germain Nouveau. Il faudra parfois des années pour décanter la situation.
En 1895, dans l’édition complète des œuvres de Rimbaud, préfacée par Verlaine, figure encore le sonnet « Poison perdu » dû à Germain Nouveau.
A côté de cette appropriation esthétique toute circonstancielle, l’annexion de Rimbaud fut aussi un enjeu idéologique.
La première tentative fut de la faire rentrer dans l’ordre bourgeois des choses, en réduisant son œuvre aux dimensions d’une crise morale vécue par un adolescent exalté et génial.
L’aventure de Rimbaud s’écrirait comme une recherche spirituelle s’achevant par un consolant et fort édifiant retour au giron de l’Eglise, après la longue pénitence du séjour chez « les nègres ». Des moyens supposés efficaces furent à cet effet mis en œuvre, et Paterne Berrichon, son beau-frère, s’employa à « normaliser » les lettres de Rimbaud afin d’aider le modèle à ressembler au portrait, allant même, ironie savoureuse, jusqu’à rajouter des touches artistes aux lettres d’Abyssinie, jugées trop « sommaires ».
La pièce majeure versée au dossier de son brevet de catholicisme est le récit de son agonie par sa sœur Isabelle. Selon les propos qu’elle rapporte du prêtre qui assiste son frère, il avait « la foi, mon enfant. Il a la foi, et je n’ai même jamais vu de foi de cette qualité ».
Cette thèse développée, on l’aura compris, par la famille soucieuse de respectabilité pour l’enfant perdu, reçut le soutien majeur de Paul Claudel, ce qui lui permit dès lors d’apparaître comme l’une des clefs de l’œuvre et de l’homme.
Il fallait en effet faire le lien entre le mourant que décrivait Isabelle, et l’enfant qui avait presque vingt ans plus tôt enfreint toutes les normes.
En juillet 1912, dans la Nouvelle Revue Française, Paul Claudel donne un article qui décidera désormais d’une nouvelle vision de l’œuvre de Rimbaud.
Claudel proclame que sa propre conversion au catholicisme plonge ses racines directement dans la lecture qu’il fit en 1886 des « Illuminations ».
A travers l’œuvre, il détecte « un mystique à l’état sauvage », un mystique barbare, quasi inconscient, mais dont l’inspiration se compare de façon flagrante à celle de sainte Jeanne de Chantal !
Sans doute Rimbaud – trop jeune, trop exalté, trop orgueilleux pour être clairvoyant ? – n’a pas voulu reconnaître le souffle qui l’anima, la Voix. Mais c’est bien Dieu qui se manifeste en lui, contre qui il « littérature affreusement », jusqu’au silence, au long silence de la fuite, qui n’est pas le prix à payer d’une ignorance, mais encore le refus obstiné de reconnaître le Maître.
Comme il existe un raisonnement par l’absurde, Rimbaud fait de Dieu la preuve par la négation perpétuelle. Partant, toujours selon Claudel , il a voulu se refuser à l’appel, a tenté l’anathème, le silence, l’éloignement, la quasi disparition pour finalement se rendre sur son lit de martyr à l’évidence qui le poursuivait.
Bien sûr, c’est faire peu de cas de la lecture littérale de l’œuvre, c’est forcer souvent l’interprétation, mais qu’à cela ne tienne, « Est-ce un fait commun que de voir un enfant de seize ans doué des facultés d’expression d’un homme de génie ? Aussi rare que cette louange de Dieu dans la bouche d’un nouveau-né dont nous parlent les récits indubitables », et voilà pourquoi votre fille est muette !
Rimbaud, ou l’ectoplasme de Dieu. Il fit sa volonté et son honneur, celui des Cuif, le nom de madame mère, celui des Berrichon sont saufs.
Le 13 mars 1947, entrant à l’Académie française au fauteuil de Paul Claudel, François Mauriac déclarait dans son discours de réception : « Arthur Rimbaud, ce voyou, ce démon, cet ange qui fut dans notre vie le précurseur et l’annonciateur de Dieu ».
On peut trouver amusant que l’autre remarquable appel de paternité à Rimbaud soit le fait d’André Breton – a qui certes, Berrichon n’aurait rien demandé ! Le pape – curieux qu’il ait fini Pape – du Surréalisme revendique en effet Rimbaud parmi ses prédécesseurs en matière littéraire et également comme l’une des figures tutélaires pour les artistes et intellectuels engagés au service de la Révolution.
« Transformer le monde » a dit Marx. « Changer la vie » a dit Rimbaud. Ces deux mots d’ordre pour nous n’en sont qu’un. »
Côté littéraire, ce sont quelques pièces qui font référence, quant aux pratiques qui seront celles du groupe surréaliste : « Rêves », que Breton célèbre dans Minautore N° 6 et où il devine les effets de l’écriture automatique ; « Alchimie du Verbe », « si le chapitre d’Une Saison en Enfer ( que ce titre) désigne ne justifie pas toute son ambition, il peut être tenu… pour… l’amorce de l’activité que… le surréalisme poursuit » ; la lettre à Paul Demeny dite «du voyant » où Breton repère des préfigurations de la révolution qu’il entend bien accomplir au moyen de l’art pour toute la société.
Il établit un parallélisme entre ses propres recherches de jeunesse et celles de Rimbaud : « j’avais été amené à fixer mon attention sur des phrases plus ou moins partielles qui, en pleine solitude, à l’approche du sommeil, deviennent perceptibles pour l’esprit sans qu’il soit possible de leur découvrir une détermination préalable… Je m’étais figuré que Rimbaud ne procédait pas autrement ( Premier manifeste du Surréalisme) ».
Côté conscience politique, Breton en appelle aux poèmes écrits sous la « pression des événements de la Commune » : « Les mains de Jeanne-Marie », « Le cœur volé », « Paris se repeuple », et le « Chant de guerre parisien » pour affirmer la fibre « sociale » de l’enfant des Ardennes.
Il n’est pas jusqu’à la rareté des morceaux « politiques » qui ne milite, à son avis, en faveur d’un Rimbaud révolutionnaire. Dans un discours prononcé le 1° avril 1935 à Prague, exposant les contradictions irréductibles qui s’imposent à l’artiste qui réalise une œuvre personnelle tenant d’une vision prophétique du monde, et que l’on veut faire témoigner d’une aventure collective, Breton s’autorise de l’exemple de Rimbaud pour réclamer du parterre de notables communistes qui constitue son auditoire qu’ils renoncent à l’asservissement de l’art. « Nous restons nombreux encore dans le monde à penser que mettre la poésie et l’art au service exclusif d’une idée, par elle-même si enthousiasme qu’elle puisse être, serait les condamner à bref délai à s’immobiliser… »
Mais, autant le poète correspond à son romantisme révolutionnaire, autant le commerçant, le supposé trafiquant d’armes ou d’esclaves ne peut s’inscrire idéologiquement dans la lignée du précédent, et donc, doit être dénoncé comme radicalement autre. Lautréamont, qui laisse une œuvre de dynamiteur extrémiste et disparaît corps et biens satisfait bien plus pleinement ses besoins de théoricien.
Breton, qui dénonce toute solution de continuité dans le déroulement de l’expérience rimbaldienne, en viendra au fur et à mesure de ses communications, à prendre ses distances vis-à-vis de Rimbaud. Comme il se doit en bon surréaliste, il finira même par instruire son procès au titre « qu’il est impardonnable d’avoir voulu nous faire croire de sa part à une seconde fuite ( son abandon de la littérature) alors qu’il retournait en prison », sans compter, au prix d’un sophisme admirable «qu’il est coupable d’avoir permis des interprétation de son œuvre telle celle de Claudel » !
Il est vrai que dans le même ordre d’idée, Breton tenait rigueur à Edgar Poe de susciter des vocations de policiers : « Les maîtres que se choisit la police moderne, vous admettrez que ce ne puissent être les nôtres » (Lettre d’A. Breton à Rolland de Renéville – 2 février 1932).
Jean-Michel Lévenard
Cet article a été publié en 1991
dans la Revue FLORILEGE.
Revu et mis en blog
Pour la Fête de la Faim
au mois de Bouffe
l’an X de la Cass’Hure
Un boute-en-train de la Révolution : Rétif de la Bretonne
( Le terme boute-en-train est ici au sens qu’on lui reconnaît dans les haras)
La Révolution n’aurait-elle fait que couronner le mouvement centralisateur qui court les siècles - dont Louis XIV représente la version royale que son arrière-petit-fils ne put maintenir ni ne sut transformer quand la République permit l’émergence de la version jacobine, puis l’interprétation monocratique de l’Empire - que l’essentiel des aspirations de Rétif eut été satisfait.
Préfigurant les effets d’une échéance qu’il appelait de ses vœux, Rétif n’imaginait pourtant pas une société régénérée - c’est là un mot clef de ses « Nuits Révolutionnaires » où, tenant une critique des évènements parisiens pendant les années troublées de la Révolution, il l’intitule « Le journal des Français ou le Régénérateur » - qui se mit en place dans de telles convulsions. Tout devait s’ordonner suivant ses plans depuis un pôle actif dominant et régentant la mutation du monde : le Roi, auquel Rétif restera longtemps très attaché, lui semblait l’homme de la situation.
Ayant rêvé, plus que pensé, une société idéale dans la « Découverte australe par un Homme-Volant » ou - et ce second titre est fort révélateur - « le Dédale français », Rétif s’était accordé, dans cette « nouvelle philosophique » publiée en 1781, la facilité de bâtir dans un espace vierge.
Sa société utopique avait l’apparence de ces autres manifestations d’un esprit novateur que furent les constructions monumentales de Claude-Nicolas Ledoux, dont les Salines d’Arc-et-Senans demeurent l’image exemplaire : là tout n’est qu’ordre, calme, symétrie proportionnée et hiérarchie réconciliée dans l’ordre naturel des choses.
On sait que ces constructions, hors du temps se situent également hors du monde, premiers balbutiements faits de pierres de plus vastes architectures où s’unifient dans une vision totalisante des univers clos où la généreuse volonté du bonheur commun accouche de citadelles totalitaires. Fourier sera au XIX° siècle l’archétype de ces concepteurs de formidables monstres sociaux, lui qui réglera dans leurs moindres détails pour les siècles – il y a une inspiration monastique et millénariste indéniable dans sa théorie de l’économie politique – l’organisation matérielle ainsi que la vie spirituelle et les obligations sociales dans ses superbes et carcéraux « phalanstères ».
Pour en revenir à Rétif, il transporte sur des îles lointaines quelques humains de choix qui fondent une méritocratie dont la légitimité particulière tient surtout à ses yeux au fait que son initiateur – Victorin – est mal né en France.
On sait deviner sous le modèle Rétif lui-même dont l’un des plus cuisants regrets, l’une des plus fortes amertumes aura été de naître roturier en un temps et un monde – ceux de l’Ancien Régime – où cela constitue une tare rédhibitoire.
Autant d’ailleurs, avant la Révolution, il recherche et se complaît à citer ses quelques relations dans les rangs aristocratiques, autant il n’y aura guère de coupable plus grand pour lui que la noblesse lorsqu’il faudra chercher des responsables aux malheurs de la France.
« Aristocratie… c’est une grande femme… elle est maigre, sèche, elle eut l’air noble, mais elle ne l’a plus que méchant… La gueuse orgueilleuse, ivre de joie d’avoir de l’argent, de l’or, s’avance dans le faubourg… »
Il avait su détecter nombre des dysfonctionnements qui entravaient la bonne marche de la société et y avait répondu par autant de placets qui énonçaient les remèdes propres selon lui à régler les « arts utiles » et le gouvernement des hommes.
Ce système comprend, rédigée inlassablement durant trente ans, une série d’études disparates mais convergentes : le «Pornographe» », le « , les «Gynographes», l’ «Andrographe», le «Thesmographe », à laquelle il faut adjoindre les nombreux romans de Rétif qui tous sont «propres à diriger les filles, les femmes, les épouses et les mères ». Le sort des « personnes du sexe», qu’il entendait guider sur les chemins de la vertu, est une préoccupation constante chez Rétif qui s’opposa trait pour trait à Sade, voulant édifier ses contemporaines en flétrissant les propos et les opinions du « Divin Marquis », rédigeant une «Anti-Justine ou les Délices de l’amour», même si, deux siècles plus tard une réputation partagée quelque peu sulfureuse leur vaut d’être réunis sur le même rayon des bibliothèques.
Ce savant échafaudage ne manque pas de résonances modernes, puisque l’on relève dans la Constitution modèle que Victorin établit sur les îles qu’il « colonise », et qui reflète les idées que Rétif a développées dans ses différents écrits, la communauté des biens de production, la suppression des classes sociales, l’allocation de ressources en fonction de la taille de la famille, l’enseignement public et obligatoire, la réglementation du travail, la réfutation du pouvoir prétorien et l’égalité devant la loi.
Pourtant, dans les «Nuits Révolutionnaires» qu’il rédige au fil des événements entre juillet 1789 et octobre 1793 il n’est guère question de ces revendications, et l’on ne découvre pas une particulière attention aux mesures qui sont édictées en ces matières. Abandonnant semble-t-il le « terrain social », qu’il avait su pourtant défricher en réel précurseur, Rétif ne s’attarde plus que sur les débats, ébats et retournements politiques, avec une complaisance et un suivisme qui correspondent peut-être après tout à l’état de l’opinion publique dont il dit vouloir être le reflet, mais qui ne brillent ni par leur art de la nuance, ni par leur hardiesse de point de vue.
Ainsi salue-t-il de manière dithyrambique le général La Fayette et le tout nouveau maire de Paris, Bailly, lors de la venue de Louis XVI en cette ville le 17 juillet 1789 :
« O La Fayette ! béni sois-tu ! car tu n’as pris le commandement que pour dignement servir ta patrie… Béni sois-tu héros des deux mondes !... Et toi Bailli ! Béni sois-tu !... car tu as mis l’humanité, la science, la modestie, la sagesse à la place de l’oppression, de l’ignorance, de l’impudence… »
Au soir du 17 juillet 1790, après le massacre du Champ de Mars, le salut a bien changé : « La Fayette ! que tu es coupable ! et toi Bailli, que tu étais faible ! »
A propos de Louis XVI, pour qui il tarit peu d’éloges jusqu’à la veille de son procès, «La postérité parlera toujours de toi, et tu es plus immortel que dix rois ensemble !... », ses paroles changent radicalement lors du procès. Quoique entrevoyant le motif politique qui condamne d’avance le roi, et qui rend dérisoire le débat sur la qualification des agissements qui lui sont reprochés, Rétif dresse un réquisitoire terrible où rien de ce qu’il avait écrit auparavant ne se retrouve :
«Coupable, comme roi, il l’était infiniment plus comme particulier… Il était parjure, parjure à la nation ! C’est le plus grand des crimes. »
La Révolution française, c’est l’irruption de la réalité dans son utopie, ce qui n’est pas sans y introduire des éléments sur lesquels il n’avait pas compté. En premier lieu, dans la «Découverte australe», le changement a lieu une fois pour toute, la « révolution », si l’on ose le terme, est une, entière, cohérente, elle naît achevée par l’entremise d’un être providentiel. Ce schéma dans son esprit ne se démentira pas, la difficulté étant dès lors de légitimer les pouvoirs successifs à qui il aura à tour de rôle reconnu la valeur de l’exemple et les plus hautes vertus et qu’il lui faudra renier et condamner sans appel l’un après l’autre.
Il entretient pour cela l’idée du complot permanent, brûlant, on l’a vu, ce jour les idoles d’hier. Sa philosophie politique explicite fort clairement cette perversion de l’esprit critique, ce ralliement, dont il s’est fait une religion, à tout ce que le nouveau souverain qu’il se reconnaît dans la Nation, au sens rousseauiste du terme, exécute par la voix de ses représentants :
« Il n’a rien de bien, ou de mal dans le vœu de la société ; quand une société ou sa majorité veut une chose, elle est juste : … la minorité est toujours coupable, je le répète, eut-elle raison moralement. »
Il n’est pas jusqu’aux massacres de septembre, qui le font pourtant frémir d’horreur, qui ne recevront sa bénédiction ou tout au moins, son absolution : «…les exécutions des 2,3,4,5,septembre étaient malheureusement nécessaires…»
Cette abdication de l’esprit le mènera à tout sanctifier, accompagnant jusqu’à ses ultimes conclusions la radicalisation de la Révolution.
Ainsi, sa profession de foi politique, rédigée le 9 octobre 1793, au moment de la dictature du parti jacobin, contient-elle en germes toutes les perversions qui verront jour dans les démocraties « populaires » : la toute puissance du parti unique, seul légitime dépositaire des aspirations du peuple : «Je crois que la vraie représentation nationale est dans la Montagne», la justification du révisionnisme historique au service de l’Etat annoncée d’ailleurs avec une franchise assez naïve : «Je crois… que les Petion, etc, loués il y a un an, étaient des traîtres», le culte de la personnalité et le mythe du sauveur : «Je crois… que Marat et Robespierre, etc, ont sauvé la Patrie», le détournement de la justice au service de l’intérêt strictement politique : «Je crois que la mort de Louis Capet a été juste, et qu’en le défendant… on n’aurait pas dû néanmoins le sauver, mais seulement prouver à la nation que son intérêt était que le dernier tyran des Français périt» - ne dirait-on pas ici décrit le scénario des futurs procès de Moscou ?
Tout ainsi, à l’avenant, jusqu’à cette notation, comble de l’art d’une certaine dialectique dont pourrait se servir encore certain maître d’aujourd’hui, car on pourra, en la matière, difficilement faire mieux :
« L’affluence anticivique, occasionnée à la porte des boulangers continue ; il semble qu’une classe de gens se fasse un plaisir d’avoir difficilement du pain. »
Jean-Michel Lévenard
Cet article a été publié en 1989
dans la Revue FLORILEGE.
Revu et mis en blog
Pour la Saint Jean des Entommeures
au mois de Bouffe
l’an X de la Cass’Hure
CONRAD DETREZ : UNE MORT ANNONCEE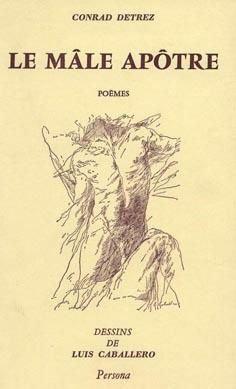
En février 1985, Conrad Detrez se suicide.
Aboutissement et signe évident d’une faille que l’examen de sa vie et de son œuvre révèle sans fard.
Cette rupture qui guide sa vie d’homme et motive sa mort, il en livre la clé dans ses romans, et particulièrement dans L’Herbe à brûler, paru en 1972, dont les allures picaresques masquent à peine le récit autobiographique.
Enfant des ciels tristes, des campagnes mouillées, des plaines betteravières à jamais embourbées, il connaît le destin exemplaire de cette Belgique-là. Car le fait d’être du pays de Liège des années 1950 n’est pas étranger à son itinéraire.
« Noircir et se noircir » conseillait savamment Céline. Conrad Detrez ne s’en prive pas dans le récit qu’il donne de son « ascension sociale ». Mais habillée, la vérité n’en demeure pas moins elle-même.
D’enfant de cœur d’un village à peine nommé, à peine nommable, jusqu’à devenir séminariste et fréquenter la célèbre Université catholique de Louvain, c’est un enlisement au cœur des querelles d’un microcosme qui s’ébroue et s’ébat à loisir dans la mesquinerie des crêpages de tonsures.
Une scène baroque et fantastique de sa « montée à la ville » pour son entrée au collège préfigure cet écœurante et doucereuse médiocrité d’un quotidien apostoliquement romain. Lui et sa mère, accompagnés du curé du village, pour s’abriter quelques instants d’une pluie battante, veulent rejoindre le couvert d’un chêne majestueusement planté au milieu des labours.
« … Les roues de nos bicyclettes s’enfonçaient. La mienne soudain pénétra dans la boue jusqu’aux moyeux… Je collai alors mes mains sous la selle et le guidon… et c’est moi qui suis descendu tel un pieu dans la terre.
… Je m’enfonçais, de la boue, j’en avais jusqu’à la hauteur de mes poches de blouson… Ma mère là-dessus a pris peur… Parvenue près de moi elle m’a saisi à bras-le-corps, a tiré, pataugé, piétiné si bien qu’à son tour elle est descendue dans le sol…
Nous sommes restés plantés, tels des joncs dans la vase, des poireaux ensevelis dans un silo de mauvaise terre jusqu’à ce que l’abbé retraversât le labour, ce qu’il a fait alors que la tête de ma mère s’embourbait. »
Et, jusqu’à vingt-quatre ans, Conrad Detrez va s’embourber dans les principes et les préceptes d’un enseignement religieux sclérosé, aux vues étroites, donnant sur la vie par quelques rares fenestrons poussiéreux et voilés de toiles d’araignées. Rien que la plus conventionnelle trajectoire, en tout conforme à la balistique théologique catholique.
Mais un jour, Detrez va se hisser jusqu’à la lucarne, frotter la vitre, puis enfin la casser.
Sans doute meilleur que ses maîtres, il a non seulement écouté mais cru leurs leçons, et réinventé à sa manière le sens des missions. C’est un être dévoué, généreux, pur qui va prendre le chemin de l’exil, d’un exil volontaire qui répond à son désir de se consacrer aux peuples malheureux. Engagement politique, activisme à la limite du terrorisme, arrestation, emprisonnement, expulsion s’ensuivront comme le déroulement logique et la conséquence inéluctable de son aspiration à partager la vie de ses « frères » en misère.
Il débarque premièrement au Brésil, et c’est là que se déchire sa vie.
Car, outre l’aventure politique qui apparaît comme le prolongement de sa vocation ,le Brésil signifiera aussi la révélation du corps. Loin des brumes, de la pluie, des frimas, les corps se dénudent, s’exhibent, vivent dans la frénésie d’un peuple qui a élevé la fête et ses débordements au rang de religion.
Les sens éveillés, Detrez vit à la fois l’extase et la damnation, et d’autant plus vivement qu’il s’affirme, au fil des tentations auxquelles il cède, à son esprit défendant mais à son corps jubilant, que ses amours les plus tenaces, les plus entières, les plus exigeantes, celles qui lui tiennent le plus au cœur, le plus au ventre, le lient le plus souvent à de jeunes hommes.
Il existe de Conrad Detrez un recueil de poèmes intitulé « Le Mâle apôtre », superbement illustré par un artiste colombien, Luis Caballero, paru en 1982.
C’est un ouvrage exutoire où Detrez se livre à un exercice de massacre pour exorciser ses fantasmes. Il s’agit de se prouver que ces amours sont des vices, qu’il n’est point de sincérité qui puisse les sanctifier. Délibérément, il entretient la juxtaposition, voire la confusion, entre mœurs homosexuelles et milieu interlope, prostitution, et brosse des scènes où ses personnages, ombres glissant dans les couloirs nocturnes de villes anonymes, tous sensibles au fait religieux, se sentent en marge, rejetés de leur propre chef de la communauté chrétienne. Et tous, en conscience, constatant ce fossé entre leurs croyances et leurs pensées, s’empressent d’en faire un abîme.
Cette plaie, c’est bien sûr celle de Conrad Detrez, lourde à porter, car jamais, il n’a cessé de croire, il n’a perdu de vue la sainteté à laquelle il était promis.
« Je suis Juan de la Miseria
Maître ès-drague, docteur de la nuit
Je prie, je baise, je pleure et jouis
De bar en bar je traîne ma croix. »
Ces vers sont extraits du poème « L’étroite voie ». « L’érotisme en littérature est un chemin mort » disait François Mauriac
En effet, ce recueil qui semble plutôt le dernier tour de piste d’un dandy blasé que la confession d’un pêcheur repentant, plus un exercice de désillusion et de résignation qu’une tentative d’échapper aux « démons », est plus un constat de faillite qu’un épisode du combat, avec ce panache que confère aux poèmes un ton désespérément provocateur et d’apparente désinvolture – Don Juan ne parle pas autrement au Commandeur.
C’est le salut du perdant. Conrad Detrez sait déjà qu’il a perdu, qu’il ne se défera pas, car là serait la seule solution, la plus raisonnable, d’une morale qui l’étouffe, et qui, ironie amère, est la plus étrangère, la plus opposée à ce que nécessite sa réconciliation avec lui-même.
Etrange destinée qui vous fait d’un bloc, d’une seule pensée, d’une seule volonté, fort de vérités indélébiles, puis vous livre, écorché vif au hiatus mortel qu’insinuent les exigences contradictoires de la satisfaction du corps et de la paix de l’âme.
La solution, c’est le geste qui rend la paix au corps pour la satisfaction de l’âme.
« Mon corps avait eu le temps de subir tous les coups, toutes les caresses, toutes les faims… Mon âme avait perdu les raisons qui l’avaient fait vivre, l’avaient portée parfois très haut et très loin ; elle se sentait usée… Elle avait payé au prix le plus fort le droit de s’en aller. Restait l’amitié des plantes vertes agréables… à ce corps qui pouvait enfin… s’endormir en paix ».
PAUL LÉAUTAUD
ECRIVAIN FRANÇAIS
Cette seule mention, accompagnée des millésimes de sa naissance - 1872 - et de son décès - 1956 - figure sur la tombe de Paul Léautaud, à Chatenay. Elle reproduit très fidèlement ce qu’il avait expressément souhaité.
Il ne s’agissait pourtant nullement d’afficher ad vitam æternam un quelconque patriotisme. Toute sa vie durant, quant à cela, il n’avait jamais considéré l’esprit cocardier, sous quelque forme qu’i
Le sens exact de cette locution proprement lapidaire, Léautaud l’a donné lui-même : « Je n’ai pas mis français par nationalisme, mais uniquement dans le sens : “ dans la tradition française, langue et esprit - on l’a assez dit de moi - quand tant d’autres se sont laissés adultérer par des influences étrangères » (Journal, 1956).
Cette filiation, pleinement revendiquée, c’est celle des sarcastiques, des esprits forts, chez qui l’intelligence supplante, et relègue au besoin, le sentiment. Celle de la tenue langagière, de la rigueur de pensée et d’expression, de la maîtrise formelle au service d’une réflexion méticuleuse, systématique et mesurée.
Ceci explique que son attention en matière littéraire ne se soit guère attachée aux auteurs antérieurs à Voltaire. Trop de mièvrerie chez Ronsard, trop de grossièretés et de laisser-aller chez Rabelais - trop de liberté peut-être ? - trop de latin et de grec chez Montaigne, dont le quasi-exclusif souci du Je a pourtant tout pour le séduire. Admettons que cette érudition agace notre Léautaud totalement ignorant des langues antiques, et passons lui cette petite pointe de jalousie.
Le seul auteur de ces temps anciens qui échappe à sa vindicte, c’est Villon. Encore n’est-ce que pour servir de repoussoir aux voyous de salon de son époque : Rictus, Richepin...
Son siècle de prédilection demeurera, et de façon de plus en plus exclusive, le 18°. Là il trouve les esprits les plus proches du sien, des sensibilités qui s’accordent à son appréhension du monde, à sa sacralisation première de l’individualisme, notion élaborée précisément en ce Siècle des Lumières.
Ce qui ressort alors de ses choix, outre son goût d’une écriture épurée, ciselée, stricte, c’est son attention particulière aux écrits réflexifs, aux pamphlets et aux recueils de sentences et de maximes, toutes formes littéraires qui engagent, dévoilent et livrent leurs auteurs.
Avec de tels critères, Voltaire se retrouve naturellement en position de parangon de la littérature française, à travers Candide, que Léautaud place au pinacle, mais également de tous les autres contes philosophiques et de sa correspondance, joyaux de finesse, d’intelligence, et surtout œuvres critiques, consignations d’un entomologiste des âmes, d’un spirituel épingleur des hypocrisies sociales.
Chez Diderot, il se suffit du “Neveu de Rameau” - dont le personnage titre peut préfigurer Léautaud lui-même, sa rouerie, son cynisme, sa sincérité provocante, voire abusive - où il retrouve son propre anti-conformisme pédagogique et cette vocation à traquer la “vraie vie”.
Il apprécie spécialement les moralistes, leurs regards perçants qui décèlent de l’âme humaine les plus subtiles circonvolutions. Il jouit littéralement de ces mises à nu effectuées par La Rochefoucauld ou Chamfort, deux des auteurs du genre qu’il prise le plus.
Les autres admirations de Léautaud appartiennent au domaine des collectionneurs d’anecdotes dont il fait désormais partie lui-même. Les Historiettes de Tallemand des Réaux satisfont particulièrement son goût du scandale qu’il sait révéler plus de vérités sur les hommes que les récits édifiants. Il garde également quelque affection à des épistoliers parmi lesquels Paul-Louis Courrier ( ici, nous suivons Léautaud dans l’une de ses rares incursions dans le 19° siècle) dont l’esprit mauvais coucheur et la plume superbe d’élégance et de fausse naïveté (version aimable de la mauvaise foi) lui vaudrait aujourd'hui de tenir une rubrique au Canard Enchaîné. Quelques pièces de théâtre figurent également parmi ses lectures habituelles : l’œuvre intégrale de Shakespeare à qui il porte une vénération, le Misanthrope de Molière - qui pourrait lui servir de bannière : entre bons larrons, bonne foire - et le Mariage de Figaro de Beaumarchais - Figaro-ci, Léautaud-là.
Il faut bien ici faire une place spéciale à Stendhal ; il fut sans doute le modèle moral en matière d’autobiographie de l’attitude de Léautaud.
A travers Henri Brulard, les Souvenirs d’égotisme, son journal et sa correspondance, Stendhal a inauguré une voie originale dans le “parler de soi”. On peut en rapprocher les options retenues par Léautaud dans son propre journal : peu de présence du monde et de l’histoire extérieurs, exigence de sincérité, prise de champ qui permet de s’observer en tant qu’objet du récit en excluant tout sentimentalisme lénifiant, en s’offrant comme un laboratoire expérimental pour une analyse morale de l’individu dans le siècle. Il ne s’agit nullement de jouer les moralisateurs, mais de signaler une visée sur l’état moral d’une société dont le réflexe permanent a toujours été de masquer le réel derrière les paravents enjolivés des témoignages qu’elle laisse donner sur elle-même, grossièrement cousus de connivence, de complaisance et de conventionnelle obséquiosité.
Les moralistes, éventreurs de paravents, ne sont pas là pour semer la bonne parole, mais pour ouvrir des perspectives sur des hommes se montrant tels qu’ils sont, tels que nous sommes. La vertu des moralistes, que Léautaud partage, c’est d’être pour nous de vrais exemples de la diverse nature humaine, et non d’être exemplaires...
Il peut paraître déplacé, parlant de Léautaud, d’évoquer la vertu. Pourtant, littérairement, c’est le mot qui convient. Ayant longuement arrêté une ligne de conduite, il ne dérogera pas aux règles qui lui semblent devoir s’appliquer pour la rédaction de son Journal. Aucune concession, ni aux sollicitations extérieures des modes langagières, des exigences économiques, des besoins publicitaires, ni aux faiblesses personnelles d’affabulation, de cachotterie, d’idéalisation.
Le mot qui résume la préoccupation majeure de Léautaud dans la tenue de son Journal, est celui d’authenticité, à ne pas confondre avec celui de vérité. Que jamais l’expression ne trahisse l’idée, qu’elle ne soit pas une transposition, une interprétation, mais qu’elle la fasse paraître dans toute sa transparence. “Parler vrai” pourrait-on dire si la locution n’avait été de quelque usage politique.
Journaux, correspondances lui permettent de converser dans ces dispositions avec des auteurs disparus, de confronter des opinions, des expériences, de s’inscrire au bout d’une chaîne dont il espère que son propre Journal constituera bientôt un nouveau maillon.
Son ambition est inscrite dans ce prolongement, et perd une partie de son sens sans lui. La signification de ce qu’il énonce n’est complète qu’envisagée dans l’environnement littéraire et philosophique qu’il établit à travers ses choix.
Ce goût du réel explique corollairement le peu de cas qu’il fait des œuvres d’imagination et quelques solides répugnances qu’il manifeste, à sa façon, de manière absolue, et pour nous savoureuse.
Autant le conte est une forme littéraire qui a sa faveur, car à travers un monde inventé, chacun sait, auteurs et lecteurs, qu’il s’agit de parler et de juger du monde réel, autant le roman, dont le but est de nous faire prendre un monde inventé pour le réel, lui semble exécrable. Cette exécration, au-delà de la forme du roman, atteint tout ce qui tend à obscurcir notre vision, à tout ce qui dresse des “paravents”. Seront alors plus précisément visés les romantiques, dont le langage lui apparaît une panoplie d’accessoires où l’on vient puiser pour tenir un rôle face à un public, dont le lyrisme tintinnabulant entrave l’émergence de l’idée, délaie l’expression dans un bouillon imbuvable pour lui. Hugo, Vigny, Nerval feront en particulier les frais de ses “feux d’artifices”. Dans le même mouvement seront emportés les deux précurseurs, Rousseau et Chateaubriand, accusés de sentimentalisme, de pleurnicherie, d’avoir maquillé la réalité pour fabriquer une fausse image d’eux-mêmes, coupables d’avoir conçu des bâtards que sont leurs mémoires entachés d’être quelque peu romancés.
Exécrations et adulations de Léautaud, énoncées souvent avec la dernière détermination, tracent de manière nette une frontière qui, qu’elle soit effectivement celle qui isole l’esprit français, né cartésien, élevé voltairien et grandi stendhalien, du reste ( et il est vrai que la Renaissance est italienne et le romantisme allemand, alors, ne garderons-nous pas le classicisme pour nous ?) , marque surtout une radicale divergence d’optique par rapport à l’écriture. D’un côté, magnifier, bâtir des cathédrales de mots qui transfigurent le monde ; tricher dirait Léautaud. De l’autre, trancher, tailler, élaguer pour montrer l’âme des choses et des gens, garder toujours tête froide, clairvoyance et lucidité...
Habiller, déshabiller...
Léautaud avait été élu pour le déshabillage, exercice périlleux réclamant tact et audace. Car, si Léautaud a fait réaliser à la littérature biographique des pas en avant, ce n’est pas sans avoir pris le risque conscient de se voir adresser quelques reproches aujourd’hui devenus habituels. Mais à l’impudeur de la révélation de sa vie, y compris dans ses aspects les plus intimes, à la verdeur de ses opinions, il a su allier la sauvegarde de l’authenticité de ses confidences, et le refus précautionneux de toute prostitution de son projet littéraire, en préservant la pureté.
Jean-Michel Lévenard
Pour la Fête de la Négresse blonde
au mois des Géraniums
l’an VII de la Cass’Hure
Dans l’almanach du père Ubu, pour l’année 1899, Jarry s’adonnait à un exercice qui consiste à définir d’un raccourci un confrère : Pierre Louÿs, celui qui aphrodite; Renard, celui qui écorche à vif, ou Déroulède, celui qui patrouille quand même.
Quant à Jarry, André Breton, dans son Anthologie de l’Humour Noir le sacre, celui qui revolver.
On peut, dans le même esprit, parler de Léon Bloy celui qui apocalypse :
«... Il y faudrait le fer et le feu, et les déluges, des choléras, et des tremblements de terre accompagnés de tous les tonnerres de Dieu !
Mais ces choses désirables ne sont pas en ma puissance, hélas ! »
En effet, tous ses écrits, et rarement de façon indirecte, ou allusive, concourent à vouer son siècle aux gémonies, à lancer des anathèmes au nom de Dieu sur cette “société” menaçant ruine et avertie de sa fin dernière, dont, il se veut moins le Cassandre que l'exécuteur des hautes et basses oeuvres.
Il se sera peu trompé. Quittant ce monde en 1917, qu’est-ce qui pouvait bien alors sembler le contredire dans cette queue de civilisation qui se livrait à d’atroces mutilations sur elle-même ?
Le monde bourgeois qu’il avait abondamment abhorré courrait simplement, après une longue agonie spirituelle, à sa fin qu’il avait annoncée, non sans excès, et souhaitée, avec une ostensible jubilation.
Cette haine protéiforme et absolue du bourgeois - où il confond toute la société de la Troisième République, et qui n’a rien pour lui de la lunaire et inoffensive bonhomie du Joseph Prud’homme d’Henri Monnier - il l’étend au tissu social dans son intégralité. Dans Exégèse des lieux communs, où il recense les formules passe-partout qui sont le liant du quotidien, la sagesse des nations, et servent d’opinions à ceux qui n’en ont pas, il place en exergue cette phrase révélatrice : “Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient atteints”. Il se livre là à un jeu de massacre qui consiste à débusquer sous d’insignifiants propos du genre “Il y a des bornes qu’il ne faut pas dépasser”, “L’excès en tout est un défaut” - il en traite ainsi plus de trois cents ! - quelques tares ataviques et incrustées.
C’est un peu ce sorcier de village qui, soignant les grains de beauté, les gratte, autant que possible avec des ongles sales, jusqu’à atteindre l’os. Ça fait très mal, et ce n’est pas forcément salutaire.
Mais si sa haine fut quasi universelle - on n’y échappait que par exception, mais alors son enthousiasme était à la mesure de ses réserves habituelles de rancœur et de violence - il mit un soin d’entomologistes à épingler tout particulièrement le milieu littéraire.
Il se fit une spécialité de vociférer - « Je ne suis rien de plus qu’un très humble et très ingénu vociférateur. Tel est mon infime emploi dans la grande musique funèbre de ce temps » - contre ceux qu’il rassemble sous l’étiquette de “grande vermine”.
« Le Journalisme moderne que je prétends désigner assez de cette épithète lumineuse, a tellement pris toute la place, malgré l’étonnante petitesse de ses unités, que le plus grand homme du monde, s’il plaisait à la providence de nous gratifier de cette denrée, ne trouverait plus même à s’accroupir dans le rentrant d’un angle obscur de ce lupanar universel des intelligences.
... L’esprit français... rappelle invinciblement l’effroyable charogne de Baudelaire et les journalistes en sont sa vermine. »
Or, en cette fin de XXIX° siècle pendant laquelle se situe le collaboration chaotique de Léon Bloy aux différents journaux qui accueillirent ses articles satiriques - de 1882 à 1894 - sans le supporter jamais très longtemps, le journalisme découvre ses fonctions au sein d’une société dont la physionomie politique, après bien des soubresauts, se trouve être républicaine faute de mieux, et presque par inadvertance. “République des vaincus” fulgure Léon Bloy dans une diatribe venimeuse à l’occasion du quinzième anniversaire de la défaite de Sedan.
La liberté retrouvée de la presse grâce aux lois de 1881 permet aux nombreux périodiques d’être le lieu privilégié de tous les débats philosophiques, politiques ou moraux, et l’unique et puissant, mais varié, ferment des opinions, des renommées et des réussites tant mondaines que littéraires ou politiques.
Les journaux se découvrent entre autres rôles ceux de porte-voix d’une race naissante, les intellectuels, et le véhicule de la nouveauté littéraire.
Lorsque Léon Bloy s’en prend à ce milieu qu’il rend principalement responsable de l’état de l’âme contemporaine, « oxydée d’argent, intoxiquée de littérature et de politique, avachie, défoncée par tous les chiens errants de l’histrionisme, en chemin de trépasser dans une sorte de paix ignoble et épouvantable », c’est à la démocratie hésitante, balbutiante qu’il s’attaque dans le plus parfait amalgame, avec une incontinence remarquable : « Je déclare une irrévocable volonté de manquer de modération, d’être toujours imprudent et de remplacer toute mesure par un perpétuel débordement. »
Ses cibles sont des directeurs de journaux - les argousins de la pensée -, des critiques littéraires - Montmartrin, le Rossignol des catacombes ; Sarcey, l’oracle des mufles ; Wolff, l’hermaphrodite prussien -, des écrivains alors en renom - Bourget, l’eunuque fendeur de poils et englueur d’atome ; Edmond Goncourt, l’idole des mouches, la manufacture à romans ; Alphonse Daudet, le voleur de gloire ; Ernest Renan, le sage entripaillé...
On peut toutefois distinguer deux lignes de front dans le carnage qu’organise Léon Bloy, et qu’il appelle exercer la “justice littéraire” : d’une part, exterminer les redoutables, de l’autre, anéantir les dégoûtants.
Les redoutables, ce sont les athées, les libres penseurs, toutes les cliques voltairiennes, les fils de Marat et de la Gueuse de 1789, au premier rang desquels il place Victor Hugo et Jules Vallès dont il se complaira à couvrir les cadavres d’oraisons sacrilèges. Mais, il livrera surtout bataille à une forme plus contemporaine du monstre : l’école naturaliste, dont la figure de proue, Emile Zola, sera l’objet de sa part de soins tout particuliers.
Les dégoûtants, c’est la cohorte de ceux qui devraient pourtant être ses alliés naturels. Écrivains catholiques de sensibilités diverses chez qui il traque jusqu’à toujours la trouver, la tiédeur, le jésuitisme, la compromission, le charlatanisme. De cette troupe bêlante, il distingue Paul Bourget, qui rassemble pour lui toutes les tares de la bourgeoisie catholique qui n’est bien-pensante qu’à force de ne plus penser.
Mais il s’agit bien d’un seul et même combat que mène Léon Bloy pour faire prévaloir une vision de la société qu’il ne conçoit qu’entièrement soumise aux principes d’une Église triomphante. Conception foutrement moyenâgeuse qu’il prône et inventorie dans ses plus tortueuses et inquisitoriales conséquences, et qui lui fait préférer la simplicité et l’exaltation qui se manifestent à Lourdes ou à Notre-Dame de la Salette à toutes les cogitations savantes, fussent-elles sensibles ou même accordées à une quelconque spiritualité chrétienne, des servants du Veau d’Or du siècle bourgeois : la Science.
Un tel intégrisme, jamais renié, et bien au contraire revendiqué sur la place publique, ne serait-ce qu’à travers le titre de ses ouvrages, toujours provocateurs (“Propos d’un entrepreneur de démolition”, “Le Pal” - « la vénérable tradition du pal... j’entreprends de la restaurer littérairement » - “Quatre ans de captivité à Cochons sur Marne”, - ou ses souvenirs de paroissien de Lagny ) lui valut d’être la victime d’une sorte de complot du silence qui réussit à le museler puisqu’il ne fut plus entendu que d’un groupe très restreint à partir de 1894 sans avoir jamais atteint d’ailleurs un public très large.
“Le désespéré”, son œuvre maîtresse, relate cette mise à mort littéraire du dernier “belluaire” sous les coups des “porchers” !
Il est certain que son époque a grandement méconnu, voire ignoré, l’écrivain qu’il faut rechercher à travers, ou au-delà - chacun jugera - de ses imprécations. Il est celui qui dit à la fois :
« ll faut inventer des catachrèses qui empalent, des métonymies qui grillent les pieds, des synecdoques qui arrachent les ongles, des ironies qui déchirent les sinuosités du râble, des litotes qui écorchent vif, des périphrases qui émasculent et des hyperboles de plomb fondu »
et
« ... je suis un poète, rien qu’un poète... je vois les hommes et les choses en poète comique ou tragique et par là, tous mes livres sont expliqués. Je vous livre ce secret. »
Ce secret, il le donne tardivement, dans un ouvrage intitulé “Au seuil de l’Apocalypse”.
Bloy, celui qui apocalypse jusqu’au bout !
Jean-Michel Lévenard
Pour la Saint Edouard, chien breton,
au mois des Décadents
l’an VI de la Cass’Hure

